
Dans la quête de l’énonciation juste des Symphonies de Schumann, réflexion sur la dialectique du voile romantique et de la recherche d’une transparence illusoire. Chefs-d’œuvre d’un cycle qui écrit l’histoire d’une âme intranquille.
Les quatre Symphonies composées par Robert Schumann entre 1841 et 1850 constituent l’un des cycles symphoniques les plus denses de la symphonie romantique, avec ceux de Schubert, Brahms, Mendelssohn. Elles tiennent leur singularité sans doute avant tout de leur charge biographique, étant le reflet canonique de l’enfer personnel qui n’a cessé de s’accroître pour Schumann, en proie à des problématiques psychologiques intenses qui devaient finalement le précipiter dans la folie et l’emporter en 1856. Le parcours de Schumann est à ce titre celui de ce martyre tout à fait concret, et à propos duquel continue de planer un continuel malentendu – dans la confusion entre un trouble psychiatrique authentique et un éthos romantique.
Mon objet est ici de proposer une traversée de ce cycle fondamental de la symphonie romantique, tout en tentant de présenter mes références personnelles (et argumentées) de ces chefs-d’œuvre, en matière d’interprétations. Et pour débuter mon propos, alors même que j’expliquerai par la suite les raisons de ce choix initial, je désigne pour explorer d’emblée ce cycle, la version que j’élis au-dessus de toutes les autres, celle de la deuxième intégrale enregistrée (Deutsche Grammophon) par Leonard Bernstein de 1984 à 1986 à la tête de l’orchestre philharmonique de Vienne.
La symphonie comme aveu

C’est sous l’insistante sollicitation de Clara que Schumann en vient au genre symphonique en 1841, avec successivement sa symphonie n° 1 dite « Le Printemps » et celle qui sera par la suite classée comme n° 4 dans le catalogue de ses œuvres. Clara (épousée un an auparavant, de haute lutte avec un beau-père possessif) pense que le talent de composition de Robert, et notamment son sens des harmonies inventives, trouvera dans l’orchestre un terrain d’expression idéal.
Et d’emblée, composées dans un contexte de bonheur conjugal tout nouveau pour le compositeur déjà aux prises avec son abîme personnel (il fut en proie cinq ans auparavant, à sa première grave crise), ces deux premiers chefs-d’œuvre absolus disent bien le prix qu’il faut accorder au cycle dans l’ensemble de sa production. D’abord, comme pour tout compositeur romantique post-Beethoven, le positionnement par rapport au maître de Bonn est patent et déterminant en particulier dans l’appréhension de l’écriture orchestrale (comme c’est le cas avant lui pour Schubert, et Mendelssohn, Brahms et tous les autres qui suivront après lui). Pour Schumann, bien plus que pour son cadet Brahms, le dilemme est grand, entre la fameuse « musique absolue » dont ce dernier n’aura pas de mal à hériter de Beethoven, et l’option narrative d’une musique qui côtoie le « programme », sous l’inspiration de Berlioz (option que reprendra bien plus tard un Mahler dans ses premières symphonies). Même avec une référence aux massifs des lieder, Schumann va opérer ce qui n’est pas loin de nous apparaître aujourd’hui comme une synthèse entre les deux tendances, créant une intime tension entre une narrativité implicite et une intériorité jamais tout à fait abstraite. Et c’est justement dans le champ de cette expression d’une intériorité singulière que se situe l’autre aspect du prix à accorder à ces symphonies : elles sont l’histoire d’une âme. Une âme tourmentée, profondément et authentiquement, bien au-delà des postures romantiques attendues.
Le plus profond, le plus durable et le plus dommageable malentendu concernant l’itinéraire biographique de Schumann repose sur une inversion des termes, qui a obéré l’approche de son œuvre. En somme, parce que le compositeur peut à juste titre être considéré comme l’un des chefs de file du mouvement romantique annoncé par Schubert et Weber, parce qu’il en a épousé et illustré au premier rang ses idéaux et ses références, on a tôt fait de considérer son profil mélancolique à peu de choses près comme de l’ordre, sinon d’une posture esthétique, en tout cas d’un résultat plutôt qu’une cause. Même en reconnaissant dans son parcours les manifestations factuelles de toutes manières incontestables de la maladie mentale, il s’est agi finalement d’une constante confusion entre ces données et la propension romantique à entretenir le thème du mal-être. C’est cette confusion que bon an mal an on retrouve peu ou prou dans les discours convenus sur Schumann. Dans son cas, il est donc impératif de rétablir les choses dans le bon ordre en quelque sorte, et de combattre cette inversion du regard, cette fausse perspective entêtante en vertu de laquelle en effet un éthos d’artiste romantique en vient à dissimuler un mal premier et non pas second. Qu’on délaisse donc la lecture ordinaire de l’enveloppe romantique, pour déjouer le plus fâcheux malentendu : c’est d’avoir trouvé dans l’expression lyrique du sentiment et du moi intérieur qui caractérise le romantisme, le lieu et la formule de son malaise profond, que Schumann a pu produire un œuvre si « sincère » au regard de son mal. On sait l’élan constant qu’il nourrira pour l’écriture poétique (lui, fils de libraire tôt entouré des nutriments du romantisme allemand), on sait sa fascination pour les Fantaisies d’E.T.A. Hoffmann, jusqu’à en immortaliser en musique la part du malaise et du chaos intérieurs extrêmes, dans les Kreisleriana en 1837. On sait la poétisation de son lien avec Clara, dans sa correspondance ou dans sa musique elle-même. Mais précisément, face à ces données-là, la confusion s’instaure d’emblée, instillant une interprétation erronée selon laquelle dans une certaine mesure, le compositeur aura à ce point fait sienne l’idée du mal-être, qu’il aura fini par en vivre les affres.
La réalité est tout autre, et c’est certainement un biographe lui-même psychanalyste (Michel Schneider dans Schumann, les voies intérieures, Gallimard 2005 et La Tombée du jour. Schumann, Seuil 1989) qui en aura suggéré l’acuité. Non qu’il faille obligatoirement en passer par une psychanalyse de sa musique pour comprendre Schumann et qu’il s’agisse de ratifier systématiquement le paradigme de la pathologie pour l’approcher au plus près.
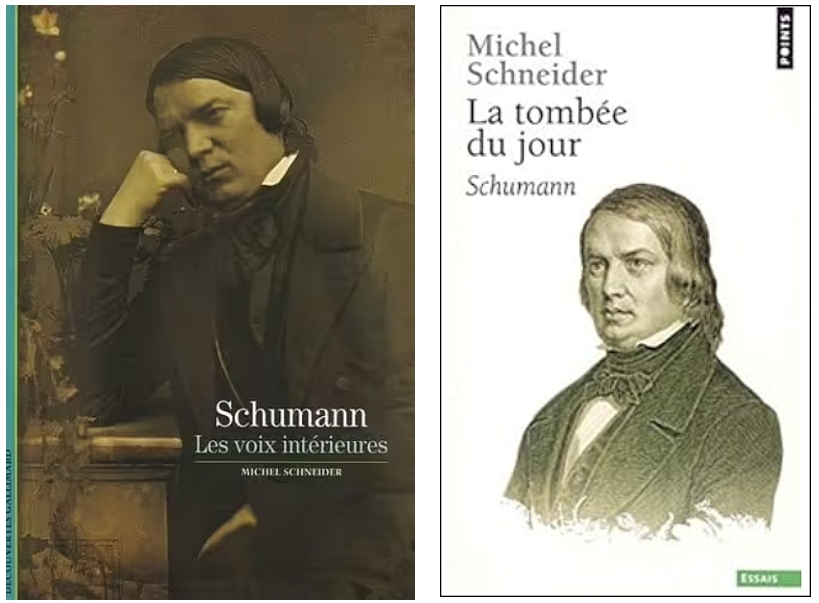
Il faut plus exactement admettre la valeur de cet accès, quand une bonne partie de sa composition en vient au territoire de la fragilité psychique. Et il faut reconsidérer la nature même du mal de Schumann, qui n’est pas de l’ordre d’un tempérament ou justement de cet éthos d’artiste romantique : ce mal, de nature psychiatrique, impossible à traiter ou à stabiliser au XIXe siècle, qui ne devait que s’accroître avec le temps, et qui n’a aucun rapport avec les troubles liés au tableau clinique de la syphilis, comme on a pu tôt le croire (ce qui atteste d’ailleurs de la difficulté de diagnostiquer cette pathologie à son époque). Car si la dépression mélancolique fait partie des premiers « maux de l’âme » à recevoir une étiologie psychiatrique, la psychose maniaco-dépressive devra attendre le XXe siècle pour voir ses causes et sa lecture clinique éclaircies, jusqu’à la mise au point de médications adaptées (les anticonvulsivants) qui seules permettront un réel traitement. À l’époque de Schumann, on tâtonne, de cures thermales en hypnose, sans parvenir à soulager ceux qui se retrouvent prisonniers de leur psyché.
Car Schumann est un authentique cyclothymique, très tôt en proie à une succession de phases euphoriques incontrôlables et de phases dépressives profondes – ce qu’on nomme aujourd’hui troubles bipolaires aigus ou en effet psychose maniaco-dépressive. Un état qu’on connaît dans sa biographie et sa correspondance sous le sceau du conflit intérieur entre Florestan et Eusebius, personnalités disjointes de fureur et de douceur qui fondent les pôles contrastés de son Carnaval, op. 9. Mais un état qui le mènera hélas à la folie et l’internement tragique de 1854 précédé d’une tentative de suicide (sa sœur s’était déjà suicidée à l’âge de dix-neuf ans).
Les symphonies sont à peu de choses près un précipité d’expression de ce mal, sans en faire pour autant un lieu de pure pathologie. Elles offrent mieux que tout autre lieu de l’œuvre (et davantage encore que les Kreisleriana), un creuset sensible fondé sur des états intérieurs exprimés jusqu’aux plus sincères et aux plus déchirantes expressions d’une angoisse existentielle qui provient de ces états euphoriques et dépressifs alternés. On est très loin des débats oiseux sur la légitimité de la lecture de l’œuvre artistique à l’aune de la biographie : ici, la symphonie incarne le lieu musical par excellence d’une âme qui s’épanche sans le moindre faux-fuyant, jusqu’à une lecture étonnamment limpide, de ce point de vue. Comme si en quelque sorte, le compositeur avait voulu tenir le journal de son mal à travers ses symphonies en particulier. Schumann aura choisi de faire de ces quatre symphonies les vecteurs privilégiés de cet état d’instabilité psychique qu’on apprend à connaître quand on fréquente son œuvre. C’est en quoi les deux premières de ces symphonies (respectivement n° 1 en si bémol majeur op. 98, « Le Printemps » et, deuxième dans l’ordre de composition, la n° 4 en ré mineur op. 120) sont des lieux où se déploient les repères d’une esthétique de l’aveu. Ce sont là, les deux premières parts d’un manifeste de l’intime qui va encore s’étoffer avec les n° 2 et n° 3, la « Rhénane ». Lire ces œuvres au-delà de leur description formelle, c’est aussi savoir y déceler les moments cruciaux d’une instabilité ontologique où on côtoie l’abîme. C’est par cette lecture qui fait toute sa place au sens sensible (presque au cri qu’on entend là), qu’il est possible de dépasser un trait convenu, presque un cliché : je veux parler de la fascination elle-même très romantique pour le lien entre génie et folie. Un lien sur lequel on a tant écrit au XXe siècle – et je pense là à une tradition, dont l’ouvrage d’Artaud sur Van Gogh (Van Gogh, le suicidé de la société) est un peu le maître-étalon. Loin d’un pathos figuré, il est question dans ce cycle symphonique, des tribulations bien réelles d’une âme torturée.
Symphonie n° 1 en si bémol majeur op. 38, « Le Printemps »
La Symphonie n° 1, « Le Printemps » demeure ce haut lieu de l’euphorie qui pourtant émerge d’une sorte de léthargie de l’introduction Andante du premier mouvement, et qui ensuite ne va cesser de s’étoffer et de monter en surenchère d’une extase qui ne trouve pas son havre, un débordement de l’énergie qu’aucune jauge ne vient contenir. Le Larghetto qui suit est de l’ordre de l’épanchement élégiaque où l’on retrouve un peu le Beethoven de la « Pastorale », autre versant de l’élan du premier mouvement, mais qui désormais s’élance en recherche d’une symbiose avec la nature, un refuge auquel postulait l’allegro initial. Une harmonie somptueuse se déploie là, qui prépare Mahler.
Le Scherzo expose un thème farouche mais surtout résolu qui ne vise que le chant. Une nouvelle déclinaison de l’élan initial, qui vit ici une affirmation, une vigueur confortée de s’être élargie par la cantilène du mouvement lent. Des échappées d’énergies qui dessinent par la suite, en volutes, des variations parfois songeuses, qui enchaînent finalement l’Allegro final, solaire et enjoué, aisance d’un pas de pur réjouissance (avec un humour qui souvent affleure). L’année précédente, le mariage de Robert Schumann avec la jeune et talentueuse pianiste Clara Wieck induit ici une sorte de célébration du bonheur conjugal qui s’énonce en célébration printanière et, selon le programme initialement prévu par le compositeur (un programme par la suite écarté), suit la temporalité de la saison et des sentiments qu’elle implique. L’extase est retrouvée : le finale est flamboiement et pure joie.
Symphonie n° 4 en ré mineur op. 120
Composée dans le sillage de cette première symphonie, la « n° 4 » au catalogue (en ré mineur op. 120) inaugure dans le cycle, les ombres douloureuses de l’intranquillité schumanienne. Il n’est pas fortuit que Schumann, encore conforme à la tradition de la nomenclature italienne des mouvements dans la première symphonie, opte ici pour une appellation allemande plus proche des états d’âme accordés aux tempos généraux. Si l’introduction « Ziemlich langsam » (ci-dessous à gauche) instille ces ombres, on pourrait tout aussi bien penser à l’introduction de la symphonie précédente, à ceci près que l’allegro accueille en son sein une tourmente qui ne ménage pas les rappels de l’ombre, en hantise incarnée notamment par ces sentences des cuivres qui se propageront en vagues des altos, menant à un second thème lui-même exposé dans l’entrave. Après quoi, chant du thème plus volontaire que naturel, un chant forcé. On est ici en territoire de conflit, et on a à juste titre souvent cité ce premier mouvement de la symphonie n° 4 comme l’un des lieux par excellence de l’agitation intérieure. Ceux qui ont pu, par désœuvrement sûrement, critiquer l’orchestration de Schumann comme simpliste, sont certainement sourds pour ne pas entendre au contraire la subtile grammaire des instruments qui relaie les phases de cette agitation. Un mouvement d’une densité exceptionnelle.
J’ai toujours tenu la Romance du deuxième mouvement (« Ziemlich langsam », ci-dessous à droite) pour l’un des plus poignants lieux de l’aveu schumannien de ce tourment intérieur insondable qui ici tient avec la mélodie d’emblée entonnée au violoncelle, de la présence subie d’un état incurable. Les échappées, vers le violon solo qui tente de se distraire et d’apporter un baume à la douleur, seront rattrapées par le rappel de l’ombre, ou plus exactement de la pure mélancolie. Et on remarquera que tout cela s’écrit et s’entend avec une étonnante clarté et sans fracas. C’est pourquoi je crois fondamentalement que le compositeur, en une pareille page, a voulu donner les clés descriptives les plus précises de ses états mélancoliques – c’est pour cette raison qu’il évite l’outrance, pour être compris. Et c’est pourquoi y être attentif, c’est rendre justice à la sincérité qui s’est exprimée là. Je ne comprends pas qu’on ait pu comparer cet état au spleen baudelairien : c’est le ramener à la pose (car j’ai sans doute le grand défaut de toujours soupçonner Baudelaire en la matière, non d’un manque de vérité, mais d’un surcroît de spectacle). Sans doute une page musicale aura rarement été plus pure et plus simple expression de la douleur d’un état subi.
Le Scherzo (« Lebhaft », ci-dessous à gauche) tient du sursaut volontaire, renouant avec le même volontarisme que dans le premier mouvement. Un thème martial irrésistible que le Trio adoucit pour un temps, mais qui reprend sa marche incoercible, sombre faut-il le préciser. Un Scherzo qui m’habite depuis si longtemps, et qui est réminiscence très personnelle d’une lumière résolue d’après-midi assez farouche, vécu et aperçu par les persiennes d’une chambre. Le souffle de la marche en vient-il à s’auto-consumer ? C’est ce que semble dire la suite de cette narration qui veut éclore.
Le finale « Langsam – Lebhabt » (ci-dessous à droite) émerge de cet effondrement, et rappelle qu’on est au début du périple métaphysique que marque ce cycle : ici, un effacement des tourments se produit qui redonne place à une extase artificielle, donnée par un rythme obsédant et saccadé, comme en une course de fond. Les cuivres rappellent pourtant les motifs d’un fatum qui semble vouloir tout écraser, mais la résolution à la lumière triomphante rattrape même les cuivres et les envahit. Et qui, mieux que Bernstein, pour traduire cette volonté de triompher (on retrouvera ce volontarisme effréné chez Tchaïkovsky), en accélérant outrageusement le tempo de la conclusion ?
Symphonie n° 2 en ut majeur op. 61
Cette sorte de processus vers l’intériorité vraie (faite de la douleur de l’instabilité) qui avait mené en 1841 de la première à la deuxième symphonie dans l’ordre de la composition (la n° 4) ne surprendra plus l’auditeur de la Symphonie n° 2 en ut majeur op. 61, esquissée d’ailleurs dès 1841 mais achevée cinq ans plus tard 1845-1846. Le « récit métaphysique » se poursuit ici par la plus sombre des quatre symphonies, celle qui provient en termes biographiques, de la profonde dépression qui entrave le compositeur un an avant l’achèvement de l’œuvre. On retrouve sans vrai étonnement l’état d’agitation dans l’introduction Sostenuto assai du premier mouvement Allegro ma non troppo (ci-dessous à gauche). Lignes mélodiques brisées, comme si les sursauts ne parviennent pas à être dissimulés ; trémolos des cordes ; harmonie elle-même saccadée par endroits : tout est cassure dans ce mouvement qui cherche son expression, en pleine tempête.
Le Scherzo, ici deuxième mouvement (ci-dessous à droite), indique par sa position atypique que la course qui s’étend en l’occurrence n’a rien de primesautier : agitation maladive, phase de l’euphorie qui comme naguère ne laisse guère de repos. Je suis encore frappé par la limpidité de l’expression qui se joue ici : exposé clair d’un état obsessionnel car si on peut penser parfois à Mendelssohn, les données de ces phrases saccadées ne sont pas de lumière mais d’un jour hagard et livré à l’épuisement. Je me permets de préciser que le sujet en proie à la phase d’excitation dans la psychose maniaco-dépressive, peut en venir à convulser. Et Bernstein n’hésite pas, qui emploie tous ses moyens d’amplification de tempo et de volume, pour étouffer toute respiration dans cet enfer hystérisé.
Pure douleur et pure sincérité que l’Adagio espressivo, troisième mouvement (ci-dessous à gauche). Une amertume qui se répand en jeux harmoniques des vents et en une sorte d’étirement voué aux cordes (là encore, Mahler n’est pas si loin). Étirement pathétique s’il en est, plainte déchirante qui ne trouve aucun recours, aucun secours : issu d’un désespoir intégral, l’un des mouvements lents les plus somptueux et les plus tragiques de Schumann.
L’Allegro molto vivace final (ci-dessous à droite), qui surgit sans transition après ce moment de pure douleur, a de quoi surprendre avec ses accents presque joyeux. Et là encore, la lecture psychologique n’est pas un aplat sur une coloration mystérieuse : Schumann avait lui-même indiqué qu’il s’agissait d’une sortie de l’état dépressif. On comprend dans le développement, que la confusion domine pourtant cette joie célébrée en victoire. Mais à la différence du finale de la Symphonie n° 4, il ne saurait être question ici de l’artificialité d’un volontarisme forcené, mais bien de cette expression sincère d’une sortie momentanée de ténèbres intérieures.
Symphonie n° 3 en mi bémol majeur op. 97, « Rhénane »
En 1850, la carrière de chef d’orchestre de Schumann culmine après plusieurs échecs, car il dirige désormais l’orchestre de Düsseldorf. Mais bientôt, cette nouvelle nomination sera entravée par ses troubles. À la tête de l’orchestre au cours de certaines répétitions, il lui arrive fréquemment d’être prostré sur place, le regard dans le vide et sans aucun geste. On le raccompagne, face à une aphasie temporaire qui rend impossible toute communication. Schumann vit désormais dans la terreur de revivre une nouvelle crise, de celles qui l’ont mené au bord du suicide lors des années précédentes. C’est pourtant dans ce contexte de plus en plus inquiétant qu’il conçoit deux de ses plus grands chefs-d’œuvre, le Concerto pour violoncelle et la Symphonie n° 3.
L’inquiétude est quant à elle exempte de cette symphonie qui semble au contraire être celle du ressourcement auprès de l’énergie brute du Rhin, du « Vater Rhein » vers le delta de soi, ce fleuve chanté par les poètes romantiques et dans lequel pourtant Schumann se jettera quatre ans plus tard, en une tentative désespérée d’en finir avec ses tourments. Cette ultime tentative de suicide rappelle une ancienne fascination pour les fleuves, et une attirance pour les gouffres de l’eau qui va. La grandiose allure thématique du premier mouvement « Lebhaft » (ci-dessous à gauche) est un chant du pur espace et du pur sentiment de plénitude, celui d’un flux inaltérable que les envolées rythmiques dessinent et exaltent. L’une des plus admirables pages symphoniques du compositeur, sans conteste. Je dirai plus loin quelle en est selon moi la plus éminentes interprétation.
Encore un Scherzo en guise de deuxième mouvement (ci-dessous à droite) , qui embrasse la volupté par de larges aplats mélodiques et une énonciation généreuse – où plus que jamais, je conçois comme réflexe moutonnier cette réputation d’orchestrations sommaires qui a été faite à Schumann. Les vents et les cordes ici se relaient en vertu d’un savant dosage du lyrisme. Somptueux.
Le mouvement lent qui suit (ci-dessous à gauche) ne rompt pas le charme, au contraire il le diffracte. Il faut attendre le quatrième mouvement, « Langsam- Lebhaft » (ci-dessous à droite), pour retrouver ces accents tragiques de la fatalité qui avaient enserré les symphonies précédentes. Ce mouvement apporte au cœur du lyrisme la touche sombre qui rappelle l’ombre, au point qu’on peut se demander si ce contraste ne constitue pas en quelque façon le centre de gravité de l’œuvre.
Le finale (ci-contre, pour cette symphonie en cinq mouvements) renoue avec la lumière franche du premier mouvement, dans le sens d’un large élan de marche triomphale (encore Tchaïkovsky préfiguré dans certaines de ses conclusions volontaristes). L’harmonie d’un lyrisme avoué trouve en cette fin triomphante une sorte de couronnement, qui renforce surtout la vive sensation de l’architecture de l’écriture symphonique de Schumann (à l’instar de son modèle beethovénien). En insérant les accents d’une expression tragique au sein du quatrième mouvement, le tourment n’a pas déserté la scène lyrique schumanienne, makis a été reléguée en une dernière portion de la symphonie, quitte à ce qu’elle soit « rééquilibrée » par un élan réitéré dans le finale, rendu ainsi nécessaire.
Dialectique du voile et de la transparence

Je rejette l’esprit de système dans le champ des choix d’interprétations. C’est l’une des expressions farouches et tenaces de la lourdeur d’esprit. Il faut, il est indispensable de « se fier à soi-même », quand on sait, à un moment donné de sa propre fréquentation des œuvres, qu’on est décidément à même de se passer des béquilles et des ersatz d’analyse que « les autres » déploient au kilomètre, quand ce qu’on a soi-même pu comprendre au gré de cette longue fréquentation (on le ressent pour soi et on sait l’argumenter) vous a mené sur des cimes intérieures, mais a pu surtout aiguiser votre propre jugement esthétique. Pour être dès lors capable de devenir soi-même sinon prescripteur de goût, mais transmetteur d’un sens qu’on peut expliquer à autrui, en une argumentation qui porte la transmission possible, dans la diversité des interprétations d’une grande œuvre musicale ou d’un grand cycle d’œuvres… il faut consentir à un tournant, qu’on se doit d’assumer. On est ainsi à même de déjouer les jugements à l’emporte-pièce, et les courtes vues dans le même élan.
Je crois avoir franchi ce seuil à maintes reprises dans ma consultation souvent compulsive des critiques émises par le musicologue américain David Hurwitz, auteur de plusieurs ouvrages remarquables mais aussi fondateur et éditeur de la célèbre plateforme « Classics Today.com » et animateur inlassable et stakhanoviste de sa chaîne YouTube « The Ultimate Classical Music Guide ». C’est là qu’au gré de plus de 3000 vidéos maintenant, le musicologue et critique fournit quotidiennement de précieux repères pour l’appréhension des interprétations accumulées dans l’histoire de la discographie, jusqu’à l’actualité, mais aussi à propos de quelques approches des répertoires et des compositeurs en général. Une source précieuse et constamment renouvelée dans laquelle on se prend à errer avec plaisir, et au gré de laquelle on apprend aussi à se confronter aux jugements argumentés mais souvent tout à fait contestables du critique. Sauf à ratifier un quelconque propos d’autorité, on se plaît ce faisant, à confronter ses propres jugements (quand ils se fondent sur une argumentation réelle) à ceux du critique américain, souvent affirmatif il faut le reconnaître, jusqu’à adopter un ton parfois ouvertement péremptoire. C’est là son style, et on est en droit de ne pas l’apprécier ou au contraire d’y trouver écho. Je me refuse pour autant à tout ratifier face à quelque critique musical (ou littéraire, ou pictural) que ce soit, quand non pas une simple opinion de mon cru mais une réelle analyse provenant de cette longue fréquentation que j’ai dite, me permet « d’y voir plus clair », notamment dans le foisonnement des interprétations d’une même œuvre. Et s’il se trouve qu’effectivement je suis souvent d’accord avec les analyses de Hurwitz, dans d’autres cas je les conteste fondamentalement – et je m’en reconnais non seulement le droit, mais de surcroît la pleine légitimité, qui me permet d’argumenter ces désaccords de fond. Le désaccord fondamental que j’ai vis-à-vis de sa vision des approches des quatre symphonies de Schumann me donne l’occasion de fournir là un exemple canonique de ces cas, en un exposé que j’aimerais lier à ce que j’ai tenté de décrire précédemment. Voici pour commencer (vidéo ci-dessous) le classement de David Hurwitz, dont je ne partage que certaines options – j’y viens.
Tout d’abord, je récuse fondamentalement la relégation de l’intégrale enregistrée par Karajan, à n’être qu’une expression caricaturale de son tropisme de legato qu’on connaît certes, mais qui en l’espèce n’aboutit en rien à cette mélasse oléagineuse qui est fustigée ici. Au contraire, les versions de Karajan des quatre symphonies respectent pleinement l’esprit même du clair-obscur parfois violent qui innerve ces œuvres. Loin d’une vision unidimensionnelle, la lecture de Karajan rend pleinement justice aux pleins et aux déliés de la masse orchestrale engagée implicitement dans l’écriture schumanienne, et rien qu’en cela, même si elle peut légitimement ne pas faire l’unanimité, elle pose en tout cas la question que ne manquent pas d’amener ceux qui (comme David Hurwitz en l’occurrence) n’en sont pas convaincus – et cette question, c’est celle de la sacro-sainte « clarté » de l’énonciation, opposée au « voile » d’une masse plus abrupte.
Or, c’est bien là qu’il faut (sans pour autant en faire une question purement théorique mais en y impliquant les références existantes) se résoudre à choisir le critère décisif. Car sans y voir plus loin que la simplement question de la sonorité (une œuvre musicale en général ne se résume jamais à une affaire d’equalizer), on s’interdit de comprendre et d’envisager précisément la « juste énonciation » pour des œuvres comme celles-là, qui engagent des enjeux d’expression extra-musicaux ou plus exactement, dont la nature amplifie l’acception musicale stricto sensu. Pour un compositeur comme Schumann qui se voulait également poète, la prise en compte de cette sémantique élargie s’avère impérative, surtout quand dans ce sens, s’insère la labilité d’états d’âme contradictoires et souvent tyranniques. En clair, on s’interdit de rien comprendre à cette écriture poétisée et psychologique, si on vise à son endroit une illusoire « clarté », qui aboutit vite à un nivellement des effets de masse (élans et ombres) et de retrait (ombres et plaintes). Le contraire contraint l’intention musicale qui se dit là à un aplanissement généralisé, là où tout est conçu selon des visées de nuances de timbre. Par conséquent, aussi paradoxale que puisse paraître sa conception, l’idéal schumannien réside davantage dans le « voile des masses » que dans la maigreur d’un chant détaché, au risque d’une maigreur des valeurs. Karajan, avec son souci parfois obsédant du legato, est donc plus près de cet idéal que ce que je considère à titre personnel comme une pure absurdité, et que David Hurwitz prend pourtant pour « Reference Recording », à savoir la version de 1972 enregistrée par Wolfgang Sawallisch à la tête de l’orchestre du Staatskapelle Dresden. Acidité du son (jusqu’à l’adoption stupide pour la musique romantique des « hard sticks » pour les timbales, baguettes dures en vigueur surtout pour la musique baroque), maigreur pratiquée jusqu’au rachitisme, esthétique du rêche : tout chez Sawallisch devant Schumann, n’est que recherche d’une ligne prétendument claire, quand l’intention même de cette musique est de faire pénétrer dans les méandres brumeuses d’une psyché angoissée. Comment dès lors, tenir cette version pour « Reference Recording » ? « Reference » pour qui, et au prix de quelle surdité devant ce qui s’énonce et s’élance dans ces cris souvent désespérés, où l’articulation a toujours son poids d’organique ?
Non : Schumann, dans la vérité de sa propre énonciation, ne saurait se satisfaire d’une quête de la transparence, mais de l’adoption éclairée d’un voile propre aux masses orchestrales. C’est en quoi la version la mieux conçue (et non pas dans une « veine romantique » qu’il faudrait considérer face à une autre veine selon D. Hurwitz : Schumann fut et demeurera toujours un romantique – l’ignorer est un contresens) est sans conteste celle de Leonard Bernstein à la tête de l’orchestre philharmonique de Vienne (la seconde qu’il grava au disque, après une première dans les années soixante à la direction du New York Philharmonic). C’est donc cette version que j’ai prise pour référence dans le survol proposé plus haut. Ici, les ombres sont les ombres, les élans sont les élans, au gré d’effets de masse inoubliables et enveloppant le spectre sonore.
Les exaltations outrées sont servies par des choix volontaires où le chef n’hésite pas à opter par exemple pour certaines accélérations de tempi caractéristiques. Les moments d’abattement sont soumis à une force lyrique qui s’élève dans l’élégie inconsolable où il s’agit de requérir des cordes la profondeur nécessaire. Et tout à l’avenant de cette science de l’expressivité qui fait la magie de Bernstein.
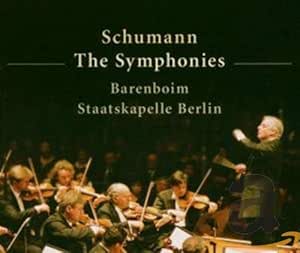
Dans cette juste veine en effet, la deuxième intégrale Barenboim des années quatre-vingt pour Teldec avec le Staatskapelle Berlin (et non pas le remake de cette intégrale avec sa seconde occurrence en 2021 avec d’ailleurs le même orchestre, mais une énergie émoussée). La toute première enregistrée par Barenboim, à la tête du Chicago Symphony Orchesrta (DG) est déjà excellent, je le mentionne au passage.
Mais surtout, si on voulait en avoir le cœur net en quelque sorte, pour ce qui est de l’alternative de la masse voilée versus la transparence trompeuse, il s’agirait de se précipiter sur le seul enregistrement dont nous disposons d’une symphonie de Schumann par Carlo Maria Giulini, je veux parler de ce chef-d’œuvre absolu de la Symphonie n° 3 « Rhénane » qu’enregistra le chef italien à la tête du Los Angeles Philharmonic Orchetra. Enregistrement somptueux et superlatif de 1982 (DG) où, couplée à une Ouverture Manfred de toute beauté (œuvre de 1848 qui emprunte à Byron la même thématique de l’âme tourmentée), la symphonie est certainement à son pinacle d’ampleur et puise dans cette ampleur même son expression intégrale, avec des accents encore plus prononcés et mieux distribués que chez Bernstein. On se prend à se plaindre que Giulini n’ait pas laissé d’intégrale Schumann, mais le chef n’avait pas l’intégrale en général comme but ni habitude. On est dans cette version, face à cette « tension » caractéristique de Giulini, chose mystérieuse et pourtant tangible dans ses interprétations, une tension qui se fait grandeur sonore dans les premiers et cinquième mouvements, et qui dans les mouvements lents rencontre à la fois un lyrisme effréné et une spiritualisation qui n’étonnera pas quand on sait l’esthétique du chef italien. Jamais sans doute, une symphonie de Schumann n’aura été gravée avec une telle exigence où tous les paramètres, décidément, sont au rendez-vous.
Schumann en ses symphonies : là où le poème s’est mué en musique, et où l’épanchement d’une âme torturée s’est fondu dans l’écriture orchestrale. Avant le cycle des symphonies de Brahms, Schumann prolonge la voie ouverte par Beethoven et continuée par Schubert, de l’expression d’une individualité dans les brumes du royaume intérieur. Jamais le « lyrisme » en musique n’a aussi profondément mérité son sens initial, dans une acception paroxystique du romantisme. Car jamais sans doute (ouvrant la voie à Tchaïkovsky, Mahler et Bruckner) les ombres intérieures (abysses qui devaient s’avérer mortelles pour Schumann) n’avaient à ce point trouvé dans les ondoiements orchestraux un espace si privilégié d’expression et d’extension, où l’aveu fait place aux cris et aux chuchotements de la douleur d’exister.
MOTS-CLÉS
