Fin de Classica, Pianiste, L’Avant-Scène Opéra : du malaise au scandale absolu
Par

En février dernier, la presse musicale française vivait une saignée inédite, avec l’annonce de la fin, en même temps, de trois titres phares, Classica, L’Avant-Scène Opéra et Pianiste. Trois titres de presse du groupe Humensis racheté en décembre 2024 par les Éditions Albin Michel, qui ont choisi, dans une logique de rentabilité à courte vue, de supprimer tout simplement trois titres essentiels de la presse musicale française. Coup de semonce ou coup de grâce, l’annonce devait susciter un émoi considérable, qui s’était alors manifesté par des prises de position virulentes (dont celle d’Alain Andrea dans Ici Beyrouth : « Assassinat de la presse musicale : la culture saigne et personne ne crie »), et nombre de pétitions (dont la mienne, qu’on pourra toujours retrouver sur Change.org – « Non à la disparition de Classica, Pianiste et L’Avant-Scène Opéra », et qui culmine à 420 signatures). En somme, malgré l’indignation, une mobilisation limitée malgré tout, qui illustre si besoin était, l’intérêt tout relatif que suscitait dans le fond ce qui demeure pourtant un véritable scandale. Il faut voir dans ce contraste, la place elle-même toute relative de cette presse spécialisée dans la musique classique en France, à l’heure d’une crise déjà ancienne et généralisée de la presse papier d’une part, et du prétendu rétrécissement accéléré du public concerné par ce segment particulier (pour parler comme les tenants des faux calculs). Pourtant donc, toutes les contextualisations économiques, les prises en compte les plus sophistiquées des réalités financières de ce secteur ne sauront jamais légitimer en quoi que ce soit ce qui restera comme l’un des renoncements les plus manifestes de ces dernières années en matière de diffusion culturelle. Tout un chacun mis devant le fait accompli (à commencer par les rédactions concernées, avec leurs dizaines de journalistes licenciés), on comprenait vite que les protestations et autres indignations publiques n’y feraient rien, et en effet, ce qui avait été annoncé s’est bel et bien accompli. Mépris des lectorats existants, mépris pour un champ réputé minoritaire de la culture, mépris souverain pour toute autre approche autre que celle des calculs capitalistiques et financiers. Le constat, le voilà, et le réel est tel : impossible de se voiler la face.
Le scandale intégral : celui que tout le monde voit et que personne n’empêche
Personnellement, pour moi qui fus un abonné de la première heure de Classica, il est aisé de mesurer la perte : ce magazine était un levier de qualité de couverture de l’actualité musicale et présentait avec Diapason, une complémentarité précieuse. Aujourd’hui, seul Diapason demeure, avec la lourde tâche d’être désormais l’unique organe de la presse française consacré à la musique dite classique. Au moment même où s’opère en France un renouvellement inédit avec une toute nouvelle génération brillantissime de musiciens, au moment aussi où le défi fondamental est de renouveler parallèlement un public qui lui, vieillit à vue d’œil, au moment en somme où la tâche d’une nouvelle diffusion de cette musique s’impose, ne voilà-t-il pas que la presse française se prive de trois titres de qualité, sans qu’aucune de ces « solutions de reprise » qu’on connaît en pareil cas dans d’autres secteurs, n’émergent pour éviter la catastrophe ou pour limiter des plans de licenciements massifs. Car la catastrophe, on y est, bel et bien, et cette catastrophe n’est pas tant un problème financier (le groupe en question avait parfaitement la possibilité soit de poursuivre les investissements, soit de céder les entreprises à un repreneur, avec une réelle volonté de sauver ce qui pouvait être sauvé), qu’une claire conscience et une claire volonté de faire ce qui doit être fait pour que la musique en France ait dans la presse, quelle que soit la crise dont on nous rabat les oreilles, des relais sûrs.
C’est donc au vu et au su de tout un chacun, que trois journaux ont disparu en un jour de la presse française. Philippe Venturini, le rédacteur en chef de Classica (qui avait succédé à Jérémie Rousseau) aura eu beau alerter, rien n’y aura fait, et le couperet de ces trois suppressions par un groupe de finance, pur scandale pour le répéter encore et encore, aura été d’autant plus révoltant, que tout se sera finalement déroulé de manière inexorable. Tout, dans le discours public tenu par bien des acteurs du secteur de la culture, semble aujourd’hui quasiment ratifier ce fameux slogan de Margaret Thatcher, « There is no alternative », car c’est bien ce qui ressort de ces paroles fatiguées, de ces consciences à qui on a déjà trop répété que décidément non, il n’y a pas de place pour la culture. Croient-ils, tous ceux-là, que la situation soit si nouvelle que cela, et que la défense de la culture ne fut pas toujours un combat ? Aujourd’hui en tout cas, le combat fut perdu, en grande partie faute de combattants.

Alors arriva ce qui devait arriver et qui avait été dit, dans cette chronique d’une mort annoncée. Avec son n° 270, Classica fermait ses portes en mars 2025, tout comme le plus remarquable organe de presse jamais consacré à l’opéra, envié dans le monde entier au point de constituer un repère historique, L’Avant-Scène Opéra, et un courageux mensuel à vocation pédagogique consacré au piano, Pianiste. Ironie du sort ou continuité du cynisme marchand (en vertu de quoi les gros gobent les petits), je recevais dans ma boîte aux lettres en qualité d’abonné à Classica, un avis concernant une offre de transfert d’abonnement à Diapason (bien inutile pour moi, également abonné aux deux titres). Ainsi va la politique commerciale de la presse, par gros temps : le réalisme avant tout.

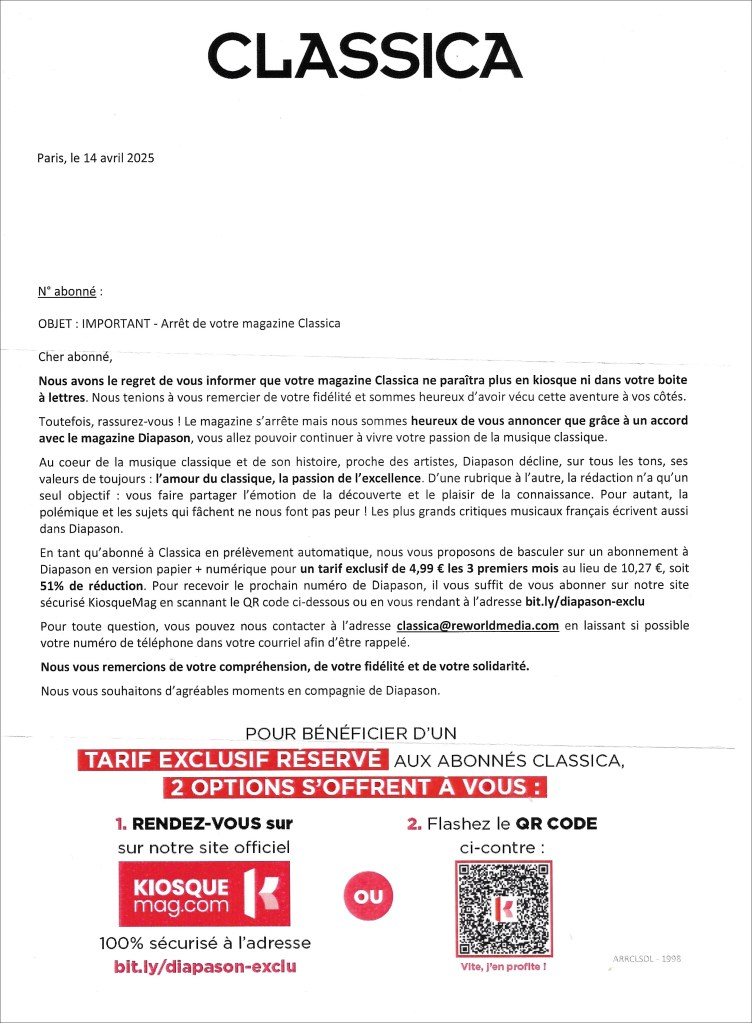
Le faux problème du public : premier leurre
Diapason, magazine de grande qualité (dont je suis tout autant abonné, je le répète) ne saurait être seul à assumer la tâche de représenter la musique dite classique dans les kiosques, en dépit de son excellence et de son ancienneté : cette situation en elle-même incarne une désolation, mais surtout un scandale. Pourquoi donc pour les arts plastiques, la presse française continue de compter plusieurs titre phares, Connaissance des Arts, Beaux-Arts magazine, Art Presse entre autres, et que la musique dite classique souffre tant ? Cette situation va-t-elle de soi, correspond-t-elle à une quelconque logique, est-elle légitimée par une quelconques évolution ? Ces questions doivent être examinées sans faux-fuyant et sans croire que les réponses vont de soi. Dès lors, il me semble opportun d’examiner la situation en se fondant sur les arguments qui ont été évoqués pour expliquer la fermeture de trois titres de la presse culturelle. Des arguments qui me paraissent tous relever de leurres, entretenus pour dissimuler en réalité un esprit de renoncement que pour notre part, nous entendons combattre.
Premier leurre, l’argument du public déclinant. Car qu’en est-il réellement du public ? En vérité, il est demandeur. Aujourd’hui, les recettes des salles de concerts, depuis en particulier la crise du covid, sont en hausse. Les festivals, éminemment fréquentés, quels que soient leurs tailles (des grandes machines comme La Folle Journée de Nantes, qui ne désemplit pas chaque année, aux festivals plus modestes qui tentent de survivre dans un contexte de coupes budgétaires des régions et des départements), font le plein du public. Et qu’y voit-on ? Contrairement à ce qui est répété à longueur de constats désolés, un public divers et pas seulement vieillissant. Soyons clairs et précis : il serait dérisoire de nier un vieillissement concret, en revanche le constat mérite d’être nuancé, à commencer par ce premier point de la fréquentation des festivals, auquel il faut ajouter celui de la fréquentation de certains concerts de la saison. En effet, à se fonder par exemple sur le profil du public de la Philharmonie de Paris lors de concerts précis comme ceux de l’orchestre de Paris sous la direction de Klaus Mäkelä, on constate souvent un net rajeunissement. Faut-il y voir l’effet d’un mécanisme d’identification de cette part du public ? Je ne vais pas tenter là une analyse psychologique, en tout cas le fait est là. Et cela ne concerne pas seulement ce type de concert où l’interprète est lui-même jeune, car je constate le même engouement pour certaines têtes d’affiche internationales : les deux récents concerts de Martha Argerich à l’Auditorium de Radio France en avril 2025 ont été suivis en majorité par un jeune public, à des proportions d’ailleurs très frappantes. Ce jeune public, constitué d’élèves des conservatoires et de bien d’autres, est donc bien là. La faute n’est à rechercher dans son absence structurelle, car cette absence traduit surtout une incapacité du monde du classique dans sa globalité, à fidéliser ce public. Certes, des efforts réels ont été consentis pour baisser le prix des places, mais là encore l’hypocrisie est la règle, car si on l’a fait, c’est souvent au détriment de la qualité desdites places, souvent à visibilité réduite. Pour qui prend-on donc les jeunes venant aux concerts ? Pour une quantité négligeable, tout juste bonne à remplir des statistiques ? Cette politique tarifaire, pour être réellement valable et sincère, devrait concerner des places de choix, si on a réellement le souci de favoriser ce public de jeunes qui ne roule pas sur l’or, loin de là. Et on comprendrait par ailleurs que favoriser ce public ne doit pas s’arrêter à une simple politique tarifaire.
Il est temps surtout, que le monde du « classique » se remette en cause et soit à même de comprendre qu’en dehors de toute démagogie, renouveler le public, qui est non seulement une intention louable, mais surtout une priorité, implique de renoncer à un certain nombre de « vieilles lunes ». Il me semble que c’est seulement à cette condition qu’on sera capable, au-delà des tarifs, de s’adresser à la jeunesse. Une remise en cause globale me semble nécessaire, et ce ne sont pas là des propos généraux. Pour me faire comprendre, je rappelle avant tout que jamais sans doute, on aura assisté en France à un tel déferlement de talents purs dans la jeune génération de musiciens, je le répète. Mais cette génération a décidé de mettre son talent et sa sensibilité dans la défense des répertoires vrais, et j’entends par là l’ensemble des répertoires susceptibles d’accueillir leur énergie de découvertes et de transmission, ce sacerdoce qu’il assurent plus que jamais, montrant la voie aux institutions elles-mêmes. Prenez toute cette mouvance du Consort, dont nous parlons beaucoup ici dans nos recensions de cd et de concerts : ces musiciens ont suscité un engouement réel et ce également auprès de leur propre génération, en effectuant un travail de fond autour d’approches renouvelées et de découvertes (voir tout le travail accompli et en cours d’accomplissement par Théotime Langlois de Swarte, Hanna Salzenstein, Sophie de Bardonnèche, Thomas Dunford, et j’en passe). Ont-ils cure, ces jeunes, des combats d’arrière-garde menés par ce milieu (et je vais y venir) ? Disons-le : les codes sociaux et intellectuels du « classique » sont en eux-mêmes redevables d’évolutions datant au moins de 70 ans en arrière. Comme il va de cette défense d’arrière-garde du naufrage sériel. Alors quand, faisant écho à une année 2025 dévolue à la célébration institutionnelle de Pierre Boulez, les espaces médiatiques ont été saturés par ce vacarme folklorique d’un autre temps, on se croyait revenu justement à ces vieilles lunes des années 50, quand Boulez trustait pour un bon temps les subventions publiques pour se livrer sous le Centre Pompidou, à un onanisme intellectuel qui en fait n’a jamais intéressé qu’une infime secte.

Est-on sûr par conséquent, de ne pas trouver quelque motif d’ironie (même si elle est involontaire j’en suis sûr), entre cet excellent journal qui disparaît, et le dossier de son dernier numéro : « Que reste-t-il de Pierre Boulez ? » J’y vois pour ma part cette ironie grinçante, justement pour un journal qui, pour l’essentiel, s’était gardé de verser dans la queue de comète d’une idéologie morte – car le combat est perdu : après des décennies passées à entériner comme une évidence la légitimité d’une dérive, cet enfermement volontaire a déjà rendu l’âme, et comme c’est le cas pour les étoiles mortes, on assiste tout au plus à son rayonnement rémanent. Or, cette dérive n’aura été possible, qu’à la condition d’un « habitus » de ce milieu, et je veux parler de son infini snobisme. Si, peu ou prou, cette presse veut survivre et intéresser un nouveau public, elle devra se garder de cultiver un jardin frelaté, conçu pour des few qu’on dit happy mais qui en fait, ne le sont pas du tout : ceux-là ont toujours tourné en rond dans un entre-soi fétide et continuent de le faire, dans la consomption de leur propre contentement. De l’air ! C’est le cri que semble adresser à tous une génération actuelle éprise de beauté.
La désolation actuelle, de ce désinvestissement massif des collectivités en termes financier, ou du cynisme qui consiste à laisser mourir d’un coup trois titres de presse, résulte à vrai dire de la conscience qu’on veut bien avoir face à la culture, face à la priorité qu’on lui accordera ou à la relégation qu’on lui réservera. Pour ne pas se jouer de mots ou de faux-fuyants, il nous apparaît donc que cette situation résulte surtout d’un désinvestissement moral et conscient dans la culture aujourd’hui, ni plus ni moins. Le public à renouveler : la vraie aventure est là, à mener sans démagogie mais sans cultiver l’air vicié d’anciennes conventions. Ce public jeune, qui est là, aussi sûrement que l’est la jeune génération de musiciens, ne demande que de l’audace de la part de toutes les institutions dont la fonction est de coordonner la transmission d’une histoire multiséculaire de la musique. La presse de ce domaine doit elle aussi assumer avec inventivité à la fois son inspiration et ses modèles économiques. Ainsi, il ne suffit pas de se recroqueviller dans un milieu acclimaté, il ne suffit pas d’organiser chaque année les « Victoires de la musique classique », il ne suffit pas de s’appuyer sur le seul sacerdoce de France Musique, il ne suffit pas de mimer le Grand Échiquier mais sans Chancel, pour qu’un renouvellement soit réellement visé. Il faut consentir à un nouveau souffle, un souffle suffisant pour balayer ce qui doit être balayé et faire renaître ce qui ne demande qu’à renaître : une transmission vraie et ambitieuse.
Les promesses du numérique : second leurre et ferments d’un nouveau souffle
Le contexte de la disparition de ces trois journaux de grande qualité, ces journaux auxquels étaient vouées trois rédactions de journalistes ultra compétents et ultra dévoués, est aussi celui dans lequel nous, Sostenuto, nous décidons d’ajouter à l’Internet musical un nouvel outil, indépendant et volontaire, déterminé et motivé. Il n’est donc pas fortuit que dans notre optique actuelle, se pencher sur cette disparition, soit aussi l’occasion de parler du lancement de cette nouvelle plateforme, de ce nouveau site. Cette concomitance me permet de mentionner ce qui me paraît, dans cette disparition de ces journaux, être le second leurre, parmi les arguments qui ont été évoqués pour l’expliquer, à savoir ce motif sempiternel du numérique, mobilisé dans ce genre de contexte comme un imperium et en particulier dans l’idée que les journaux concernés auraient fauté en quelque sorte, en n’ayant pas été à la hauteur du « tournant numérique ». Disons-le sans ambages et sans détours : cette sorte de vague incrimination constitue en soi une honte. Faire peser dans leur ensemble sur des rédactions de presse cette vague accusation d’avoir raté le coche du numérique témoigne à la fois d’une légèreté et d’une logique de l’accusation indistincte. Accuser une rédaction est une généralité irresponsable qui, en l’occurrence, a été largement exprimée et réitérée dans le cas de ces trois disparitions. Car oui, il s’agit surtout d’une indistinction, de la part de ceux (nombreux) qui méconnaissent simplement les réels enjeux du numérique. Je rappelle tout d’abord que Classica, pour ne parler que de ce journal, avait bien un site Internet très actif, très complet, très efficace. Alors que veut-on ? Dissoudre toute la presse papier et la transformer en sites Internet ? On se rend compte ne serait-ce qu’en posant la question, à quel point l’accusation est absurde, et prouve surtout qu’on ne sait pas différencier un journal papier de ses extensions numériques, par paresse intellectuelle ou par facilité. Car ces extensions ne peuvent être que complémentaires dans le cas d’un journal papier : le numérique dans ce contexte est un plus, pas une alternative. En cela, Classica (tout comme Diapason avec son site également très actif) avait un site diversifié, efficace et dynamique dans le sens d’actualisations tout à fait complémentaires par rapport à la version papier du journal. Ce n’est qu’au titre d’une méconnaissance très répandue des différenciations entre le numérique et le papier, qu’on a donc pu placer ces journaux disparus dans cette sorte de torpeur d’un horizon jamais atteint ou satisfaisant du numérique. Car ce champ du numérique a ses modalités propres qui ne peuvent à aucun titre en venir à remplacer ou annuler la légitimité du papier. Les journaux papier ne doivent pas accepter d’être placés dans cette sorte d’insécurité qui confine au mépris, au nom de quoi ils seraient finalement « ringards » et dépassés par rapport à ce qui se passe en ligne. Pure idiotie, mais qui atteste d’une absence totale de réflexion concernant le vrai rôle du numérique dans un champ culturel de cet ordre.
Certes, les données de cette initiative numérique que nous lançons sont bien différentes, car assumer la responsabilité financière d’un journal papier (avec toute la chaîne économique à laquelle il doit s’adosser), n’est pas la même chose que de lancer un site ; mais si les conditions économiques sont bien différentes, l’objectif d’une diffusion renouvelée et exigeante est certainement le même, que celui qui peut présider à la création d’un organe de presse… Prenant les choses à la base, et ayant fait le choix d’une visée différente de celle des autre sites du même genre (à savoir un propos très sélectif sur l’actualité musicale, mais aussi un propos ouvert sur la musicologie au sens large), nous agissons néanmoins dans un contexte où, selon une formule plus abordable dans sa réalisation que celle de la presse papier, notre intention demeure de contribuer à un nouveau souffle dans le champ de la diffusion de la chronique musicale. Par conséquent, la nature de notre objectif est en partie comparable à celui de ces trois journaux qui d’un coup, ont disparu de la circulation. Quelle que puisse être la difficulté (économique pour la presse papier, souvent contrainte de se lier à des grands groupes capitalistiques pour qui le propos musical n’est pas toujours une priorité, pour employer une litote ; difficulté de constance pour un site Internet lancé dans l’enthousiasme, mais qu’il faut aussi pérenniser), le ressort semble être celui des priorités qu’on se reconnaît, très personnellement. En fondant un nouvel outil numérique dans le contexte singulier de la suppression de trois médias traditionnels, nous ne ne prétendons pas nous placer dans une position en soi plus en phase avec la mission de chronique et de renouvellement de la transmission. Mais nous le faisons en ayant surtout conscience de ce qui se joue aujourd’hui dans le monde qu’on dit feutré de la musique qu’on dit classique. À savoir un tournant, qui concerne l’ampleur de la conception de ce qui doit être fait dans ce domaine. Car étant donné que je parle des perspectives de ce site dans le sillage de ce champ de ruines qui aura vu au premier trimestre 2025 le bouleversement de l’horizon de la presse musicale en France, j’en profite pour dire que dans notre intention, ce nouvel outil impliquera des extensions dans l’action : dans d’autres voies de diffusion (l’édition en particulier) et de nouvelles voies de transmission (avec notre projet Beethoven 2027, entre autres). Nous voulons montrer ainsi, que tout doit et peut être effectué aujourd’hui, pour atteindre ces objectifs de renouvellement, pour faire vivre une musique qui est une tradition qui ne peut être transmise qu’à la condition qu’elle vive – par les musiciens, mais aussi par tous les acteurs qui voudront bien s’y consacrer. Dans cette action qui doit être une conquête de nouveaux horizons, nous garderons en mémoire l’excellence de ces trois médias aujourd’hui disparus, en faisant en sorte de prolonger leur action, et en explorant des voies nouvelles.
MOTS-CLÉS
