Abdel Rahman El-Bacha, Festival Chopin de Paris, 7 juillet 2025
MOZART, Sonate en ut mineur K. 457 n° 14 | CHOPIN, Trois Mazurkas op. 59 ;
Troisième Ballade en la bémol majeur op. 47 ; Vingt-quatre Préludes op. 28

Il fut un temps, pas si lointain, où l’on voyait en l’interprète un passeur, un serviteur éclairé de la partition, avançant dans son ombre, habité par un devoir quasi religieux envers la musique et ses créateurs. À cette époque, l’art de l’interprétation échappait encore à la tyrannie du « moi » et refusait cette pathologie narcissique qui aujourd’hui le ronge jusqu’à la moelle. Il relevait d’une fidélité absolue : fidélité à une pensée, une époque, un style et une tradition scrupuleusement transmise de maître à disciple. Cette rigueur constituait l’exigence sine qua non pour aborder une œuvre avec intégrité, en ce qu’elle émanait d’une intransigeance intérieure proscrivant toute ostentation vaine, ainsi que ce nombrilisme dévastateur qui confond l’ego avec l’art. La scène appartenait alors à ceux que l’on pouvait appeler, à juste titre, des artistes ˗ au sens le plus exigeant du mot ˗ tels qu’Arthur Rubinstein, Clara Haskil, Maurizio Pollini ou Murray Perahia, des figures capables de prendre la juste distance avec elles-mêmes pour laisser la musique se révéler dans toute sa grandeur. Même lorsque Samson François, Emil Gilels ou Arturo Benedetti Michelangeli imprimaient leur singularité à une interprétation, jamais celle-ci ne prenait le pas sur le texte ni ne le déformait au profit d’une glorification personnelle.
Mais les temps ont hélas changé, et avec eux s’est effritée cette hiérarchie fondatrice qui plaçait l’œuvre au-dessus de celui qui la transmet. L’interprète, du moins dans une certaine frange surexposée, tend désormais à substituer à cette vocation une quête de visibilité. L’œuvre devient alors le reflet hypertrophié de soi, un simple prétexte à l’affirmation d’une identité, fût-elle musicale. L’obsession du geste spectaculaire et de l’effet immédiat réduit l’acte interprétatif à une démonstration, souvent vaine, de soi par soi. Loin de servir la musique, on s’en sert. Dans cette époque saturée de bruit et d’images éphémères, Abdel Rahman El-Bacha avance à contre-courant : il laisse l’œuvre parler en lui et à travers lui. Par son jeu pudique, mais ô combien virtuose, le verbe musical retrouve sa dignité première : celle d’une parole habitée, non d’un discours exhibé. Sa prestation au Festival Chopin à Paris, le 7 juillet dernier, en fut la démonstration la plus éloquente : le pianiste libano-français est parvenu à « pénétrer jusqu’aux cellules les plus intimes » de la partition, selon la pensée d’Adorno, pour en extraire la sève, révélant à l’auditeur une vérité absolue, irréductible, que seule la musique est en mesure d’énoncer.

Un romantisme en gestation
En ouvrant son récital par la Sonate en ut mineur K. 457 de Mozart, Abdel Rahman El-Bacha opte pour une œuvre de fracture, charnière entre le classicisme formel et un certain romantisme encore en gestation. Ce choix, pleinement assumé, engage d’emblée l’écoute sur un terrain de tension : entre l’équilibre et le heurt, la construction rigoureuse et le surgissement affectif. Et c’est précisément ce clair-obscur qu’il explore avec un sens pointu du détail. Composée en 1784 et dédiée à Thérèse von Trattner, l’élève de Mozart, cette sonate constitue avec la Fantaisie K. 475 un diptyque particulier dans le corpus pianistique du compositeur autrichien. L’ut mineur ˗ tonalité que l’on pourrait, sans forcer le trait, qualifier de pré-beethovénienne, et ici plus intensément que jamais ˗ imprime à cette sonate une charge émotionnelle peu commune dans l’œuvre pour clavier de Mozart. Tonalité de la lutte intérieure ou de la révolte, elle infuse la partition d’un souffle dramatique que peu d’œuvres de son temps peuvent égaler. C’est aussi l’une des premières fois que Mozart se détache des conventions stylistiques de la forme sonate pour laisser transparaître, à travers une expressivité tourmentée, les prémices d’un langage que le XIXe siècle s’appropriera pleinement.
Dans le Molto allegro, El-Bacha livre une lecture d’une grande clarté architecturale, épurée mais concentrée. Le phrasé affirmé épouse le souffle d’un discours tendu qui suit la logique interne de la pièce. Mais ce qui frappe surtout ici, c’est la densité expressive des couleurs qu’il convoque : des couleurs beethovéniennes, forgées dans l’intimité de ses deux intégrales des 32 sonates du génie de Bonn. Le premier thème, incisif et puissant, évoque une énergie combattive, tandis que le second, plus lyrique, n’en conserve pas moins une instabilité sous-jacente. Cette lecture évite le travers d’un romantisme anachronique souvent appliqué artificiellement par certains pianistes et dévoile un Mozart tourné vers l’avenir, où l’ombre du drame, la tension des contrastes et l’audace des ruptures se font déjà sentir. Là où d’autres chercheraient le brillant, El-Bacha choisit la profondeur du grain, la fermeté du contour, et laisse deviner, sous la pudeur du style, une parole en formation, celle qui, chez Beethoven, explosera.
Dans l’Adagio, la lecture d’El-Bacha met en lumière la simplicité apparente du thème tout en révélant la complexité des tensions harmoniques et des appuis rythmiques, qui évoquent, par anticipation, l’univers introspectif de l’Adagio cantabile de la sonate op. 13 de Beethoven. Le pianiste prend le contre-pied d’un lyrisme expansif, privilégiant une intériorité contenue, où l’émotion circule à travers une ligne sobrement tendue, jamais relâchée. Cette économie de moyens, soutenue par une finesse de toucher, confère toute sa force à la tension latente du non-dit. Le Rondo final, quant à lui, révèle une virtuosité mise au service d’une intelligence musicale aiguisée. Les contrastes internes, les épisodes intermédiaires aux atmosphères changeantes, ainsi que les transformations du thème, sont mis en relief avec une limpidité structurelle remarquable. La texture sonore reste fluide, jamais alourdie, même dans les passages les plus denses. C’est dans cette dernière section que le pianiste se libère d’une certaine retenue initiale : les ruptures, les discontinuités et les zones d’ombre expressives sont pleinement assumées. Il y éclaire à son apogée la modernité du style mozartien que l’on associe davantage au langage beethovénien qu’au classicisme viennois.
Deux visages d’une même passion
Dans les Mazurkas op. 59, El-Bacha offre une vision très personnelle, fidèle à sa conviction que « chaque pianiste qui sait jouer Chopin a son Chopin à lui ». Sa lecture met en avant l’intériorité du discours plutôt que son ancrage dans la danse. Si l’on y retrouve une belle noblesse de ton et un soin apporté au timbre, sa prestation privilégie une ligne fluide et réfléchie, parfois au détriment de la mobilité rythmique qui confère à ces mazurkas leur caractère capricieux, notamment dans celles en la mineur et fa dièse mineur. Une approche, certes cohérente, mais qui laisse un peu en retrait le cœur pulsatif de ces pièces. En revanche, le virtuose libano-français se montre pleinement convaincant dans la Ballade n° 3 en la bémol majeur op. 47 de Chopin.
Il aborde ce chef-d’œuvre avec une rigueur exemplaire, faisant ressortir la symétrie interne de sa construction. Dès l’introduction dolce, traitée avec un phrasé souple et flottant, il installe un climat d’attente continue qui annonce le rôle récurrent de cette section, appelée à reparaître au point culminant de l’œuvre. Le premier thème, à double profil, chantant puis dansant, est exposé avec un legato articulé qui assure la continuité du flux tout en distinguant nettement ses deux volets. L’équilibre entre les mains est finement dosé, les croches d’accompagnement se fondant au profit de la ligne supérieure, sans pour autant perdre leur pulsation interne. Le retour du motif en octaves brisées est d’une grande stabilité rythmique, évitant toute dérive expressive. El-Bacha y donne une lecture d’une objectivité revendiquée, privilégiant la fonction structurelle du motif, plutôt que son potentiel dramatique.
L’épisode en fa mineur s’insinue brusquement dans le discours par des accords martelés et une rythmique exigeant un jeu incisif. Le virtuose en assume pleinement le caractère percussif sans jamais tomber dans l’excès : chaque attaque reste mesurée, faisant de ce passage une extension logique du matériau précédent. Après une section au jeu perlé, marquée par un allègement naturel du toucher, il amorce une remontée progressive de la tension. Les octaves brisées et la mise en relief nuancée des fragments thématiques mènent au point d’orgue de la Ballade. Le tonnerre prend alors forme sous le regard d’un public ébahi, absorbé par le mouvement du jeu. La transition vers la tonalité principale est menée avec efficacité, notamment grâce au contrôle précis des grands sauts de la main gauche et de l’écriture chromatique ascendante. Arrivé à la coda, El-Bacha évite toute précipitation. Malgré l’exigence technique (arpèges, octaves et accords massifs), son articulation reste d’une clarté princière. Les quatre accords conclusifs couronnent un chef-d’œuvre que l’on redécouvre enfin dans la plénitude de son authenticité, tel qu’il aurait toujours dû s’imposer.

Orfèvrerie pianistique
Après l’entracte, l’interprétation des 24 Préludes op. 28 de Chopin s’impose comme une œuvre d’orfèvrerie pianistique. Une telle traversée, d’une richesse expressive si tenue, appellerait des pages entières pour en restituer pleinement la portée. Cette analyse se limitera donc aux cimes les plus lumineuses de cette lecture. Dès les premières mesures du Prélude en mi mineur (n° 4), l’orfèvre installe un climat de recueillement intense. La ligne mélodique, patiemment distillée, émerge d’une douleur intérieure, portée par une pédale à peine effleurée qui en éclaire les inflexions sans jamais troubler la transparence harmonique. La progression s’élabore comme une lente décantation, chaque modulation révélant progressivement les arrière-plans émotionnels de la pièce. Le dernier accord s’éteint, l’exil s’installe. Une brûlure creuse dans la peau le souvenir d’une terre perdue. Une brûlure salée. El-Bacha, plus que quiconque, habite ce silence où l’absence se fait présence. Cette retenue méditative préfigure le tourbillon impétueux du Prélude en fa dièse mineur (n° 8) dans lequel la lutte reprend avec une vigueur nouvelle et ardente, une fougue que l’on retrouvera également dans le Prélude en la bémol majeur (n° 17). Le contraste entre la main droite, agitée et incisive, et la main gauche, syncopée et insistante, engendre une tension nerveuse palpable. La maîtrise du phrasé par l’artiste fait ressortir une alternance dynamique saisissante, allant de passages délicatement ciselés à de puissantes explosions, conférant à ce prélude une intensité orchestrale.
Dans le Prélude en sol dièse mineur (n° 12), le Libanais s’élance dans une course haletante d’accords brisés : la main droite donne naissance à un mouvement perpétuel tandis que la main gauche assume un accompagnement ferme. L’énergie, contenue dans ce phrasé tendu, prend ici les allures d’une lutte intérieure, sculptée à même le clavier. Cette tension se dissipe aussitôt dans le Prélude en fa dièse majeur (n° 13), où s’élève un chant onirique, doux contraste qui invite à la rêverie. El-Bacha caresse chaque phrase d’une légèreté vocale, révélant la douceur voilée derrière les murmures d’un rêve éveillé. Ce dernier trouvera aussitôt un nouvel écho dans le Prélude en ré bémol majeur (n° 15). Le motif obstiné de la note répétée installe d’abord une atmosphère d’attente paisible. Mais cette quiétude est bientôt troublée par un épisode central plus sombre aux basses grondantes. Abdel Rahman El-Bacha joue sur cette opposition, préférant suggérer la menace plutôt que l’exposer frontalement. Le retour au calme, loin d’apaiser la tension, l’absorbe et la transforme, offrant une lumière désormais filtrée par l’ombre.
Le Prélude n° 20 en do mineur, souvent appelé le « Prélude des accords », s’ouvre sur une procession d’accords lents, graves, qui sonnent comme un glas solennel dans un paysage de deuil. Qui d’autre que Chopin peut évoquer le funèbre sans céder au pathos, comme dans le second mouvement de la Sonate n° 2 ou dans les ombres frémissantes de la Mazurka op. 17 n° 4 ? El-Bacha y instaure une liturgie musicale où chaque accord tient lieu d’oraison. Paradoxalement, le Prélude en sol mineur (n° 22) suggère un sombre présage et annonce une fin inévitable. Son rythme galopant, ponctué de syncopes, vient perturber un tempo déjà agité et tourmenté. Le virtuose crée une atmosphère presque irréelle, où la musique semble à la fois maîtrisée et prête à exploser. Les dernières mesures ouvrent directement la voie au prélude final en do mineur (n° 24), comme une marche vers l’inéluctable, vers un effondrement annoncé. Point culminant du cycle, ce prélude en do mineur, souvent associé à la gravité du Requiem de Mozart, baigne l’auditeur dans une atmosphère funeste. Le motif obstiné de la basse, répété et soutenu, accentue une tension constante. Pourtant, loin de céder au désespoir, la ligne mélodico-rythmique se fait cri de défi, exprimant une résistance farouche face à la mort. Ce monument romantique conclut ainsi le cycle sur une note de puissance et de triomphe.

Ce soir-là, Abdel Rahman El-Bacha, l’un des rares pianistes à avoir enregistré l’intégrale des œuvres pour piano seul de Chopin dans leur ordre chronologique, aura révélé toute l’étendue de son génie. En plus d’être un grand interprète de Beethoven, au même rang que Daniel Barenboim et Alfred Brendel, il occupe une place de choix parmi les chopiniens de premier plan, digne de figurer aux côtés des immortels Arthur Rubinstein, Maurizio Pollini et Samson François. Pour clore ce moment d’extase musicale, il gratifie son auditoire de deux bis empreints de grâce et de nostalgie. Il commence par la Valse en la mineur, op. posthume de Chopin, dont l’harmonie a nourri tant de controverses, offrant une version personnelle révisée, plus fidèle à l’âme du compositeur polonais. Enfin, dans un ultime élan d’émotion, il adresse un hommage sincère au Liban, sa terre natale, qu’il chérit avec une passion aussi profonde que celle que Chopin portait à sa Pologne bien-aimée. Il interprète alors une de ses propres compositions, tirée de son album Arabesques (Mirare, 2018).
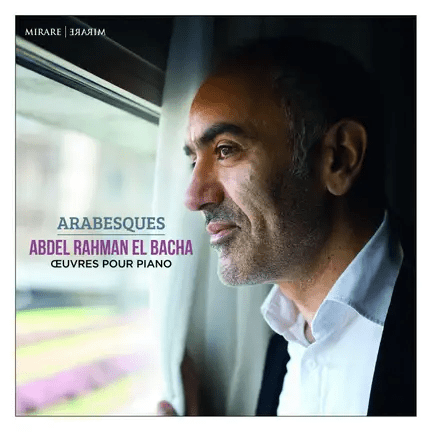
Le 7 juillet, nous aurons quitté l’Orangerie du Parc de Bagatelle le cœur serré, les yeux embués de larmes, portant en nos âmes l’empreinte indélébile d’un instant d’éternité.
